- Nos actualités
- 343 vues
- 0 commentaires

Vendanges : tout comprendre sur cette étape cruciale du vin
Chaque année, à la fin de l’été ou au début de l’automne, un ballet bien particulier anime les coteaux, les vignobles et les domaines viticoles de France et du monde entier : les vendanges. Ce moment charnière dans l’élaboration du vin suscite à la fois excitation, attention et savoir-faire. Mais que sont vraiment les vendanges ? Pourquoi cette étape est-elle si cruciale dans la production viticole ? Et comment influence-t-elle le vin que l’on retrouve ensuite dans nos verres ?
Plongeons ensemble au cœur des vendanges, ce rituel qui marque le début de la naissance du vin. Vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir : le calendrier des vendanges, les méthodes (manuelles ou mécaniques), leur impact sur la qualité du vin, sans oublier les enjeux climatiques, humains et économiques liés à cette période si particulière.

Qu’est-ce que les vendanges ?
Les vendanges désignent la récolte des raisins destinés à la production du vin. C’est la toute première étape de la vinification, mais aussi l’une des plus déterminantes. Car tout commence dans la vigne : la qualité du vin dépend d’abord de la qualité du raisin.
Récolter trop tôt ? Le vin manquera de maturité, de sucre, de rondeur.
Récolter trop tard ? Le raisin risque la surmaturité, les maladies, la perte de fraîcheur.
Le bon moment pour vendanger est donc crucial : c’est un subtil équilibre entre maturité technologique (taux de sucre), maturité phénolique (tanins, couleur) et maturité aromatique.
Quand ont lieu les vendanges ? Un calendrier variable
Contrairement à une idée reçue, les vendanges n’ont pas lieu à une date fixe. Leur timing dépend de nombreux facteurs :
- Le climat de l’année : un été chaud avance la récolte, un été frais la retarde.
- La région viticole : on vendange plus tôt en Provence ou en Languedoc qu’en Alsace ou dans le Bordelais.
- Le cépage : certains raisins mûrissent plus vite que d'autres.
- Le type de vin recherché : on vendange parfois plus tôt pour faire du vin blanc sec, plus tard pour du vin moelleux ou liquoreux.
En France, les vendanges commencent généralement fin août pour les régions les plus chaudes, et peuvent s'étendre jusqu’à début octobre dans les zones plus fraîches ou en altitude.
Vendanges manuelles vs mécaniques : deux approches
Il existe aujourd’hui deux grandes méthodes pour vendanger : la vendange manuelle et la vendange mécanique.
La vendange manuelle : tradition et précision
C’est la méthode ancestrale. Les raisins sont cueillis à la main, grappe par grappe, à l’aide de sécateurs. Cette approche est :
- Plus précise : le vendangeur sélectionne les meilleures grappes.
- Indispensable pour les tris sélectifs (notamment en vendanges tardives, vin de glace, vendanges botrytisées).
- Souvent imposée par les appellations de prestige (ex : Champagne, Côte-Rôtie, grands crus de Bourgogne).
Mais elle est aussi :
- Plus coûteuse : main-d’œuvre, logement, repas.
- Plus longue : selon la surface et le nombre de vendangeurs.
La vendange mécanique : rapidité et efficacité
Apparue dans les années 1970, la vendangeuse mécanique est une machine qui secoue les ceps pour faire tomber les raisins.
- Rapide et rentable, elle permet de récolter plusieurs hectares par jour.
- Adaptée aux grandes exploitations.
- Moins précise, car elle ramasse tout : grappes mûres, feuilles, parfois même des insectes.
De plus en plus de domaines optent pour un panachage : vendange mécanique pour certaines parcelles, manuelle pour d’autres.
Maturité du raisin : un enjeu fondamental
Avant de lancer les vendanges, le vigneron observe et analyse. Il ne suffit pas que le raisin soit sucré. Il faut aussi qu’il ait atteint la maturité optimale selon le style de vin recherché.
Les critères suivis :
- Le taux de sucre (mesuré en degré potentiel d’alcool)
- L’acidité totale
- Le pH
- La maturité phénolique : tanins, couleur (pour les rouges)
- Le profil aromatique : dégustation des baies
Les prélèvements se font régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, sur des parcelles témoins.
Le rôle décisif du climat
Les conditions climatiques des dernières semaines avant les vendanges ont un impact majeur sur la qualité du raisin.
- Soleil : favorise la concentration en sucre et les arômes.
- Pluie : peut diluer les baies, favoriser le botrytis (mauvais ou bon selon les cas).
- Vent : limite l’humidité, donc les risques de maladies.
Les années dites "solaires" (ex : 2015, 2018 dans de nombreuses régions françaises) donnent souvent des vins plus riches, plus ronds. Les années plus fraîches produisent des vins plus tendus, plus acides.
Une période intense pour les vignerons
Les vendanges sont aussi une épreuve physique et logistique. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tout doit être parfaitement orchestré :
- Main-d’œuvre à mobiliser : parfois plus de 30 personnes sur une grande propriété.
- Organisation du chantier : planning, météo, repas, transports des caisses.
- Gestion de la cave : nettoyage, préparation des cuves, suivi de la fermentation.
C’est un moment où tout s’accélère. Les décisions doivent être rapides, les journées sont longues, les nuits parfois courtes. Mais c’est aussi un moment de partage et de convivialité, souvent célébré par des repas, des chants ou des traditions locales.
Et après ? Les premières étapes de la vinification
Une fois les raisins récoltés, commence le travail en cave. Voici les premières étapes clés :
Éraflage et foulage
- L’éraflage consiste à retirer les rafles (parties ligneuses) pour éviter l’amertume.
- Le foulage éclate les baies pour libérer le jus.
Ces étapes sont de plus en plus douces ou même évitées selon les styles de vin recherchés.
Pressurage
- Pour les vins blancs, on presse directement les raisins.
- Pour les rouges, on macère d’abord les peaux avec le jus (pour extraire couleur et tanins), avant pressurage.
Fermentation alcoolique
Le jus est mis en cuve, la fermentation commence naturellement ou grâce à l’ajout de levures. C’est à ce moment que le sucre se transforme en alcool.
Les vendanges dans les différentes régions françaises
Chaque région viticole vit les vendanges à sa façon. Voici quelques exemples :
En Champagne
Les vendanges sont toujours manuelles. Le pressurage se fait très rapidement après la cueillette pour éviter toute coloration du jus (le Champagne étant majoritairement blanc à partir de raisins noirs).
En Bourgogne
La vendange est un art à part entière. Les grappes sont triées à la main, parfois sur table de tri, pour ne garder que les baies parfaites, surtout pour les crus prestigieux.
En Vallée du Rhône
On vendange souvent tôt en septembre pour préserver la fraîcheur des Syrah et des Grenaches. Les vendanges manuelles sont encore fréquentes dans les appellations comme Côte-Rôtie ou Cornas.
Vendanges et réchauffement climatique : un nouveau défi
Depuis deux décennies, les vendanges ont tendance à avancer. Là où l’on vendangeait fin septembre, on commence désormais parfois à cueillir mi-août dans le Sud de la France.
Le réchauffement climatique modifie en profondeur les cycles végétatifs :
- Accélération de la maturité
- Risque de stress hydrique
- Perte d’acidité dans les raisins
- Hausse des degrés alcooliques
Les vignerons doivent s’adapter : choix de cépages plus tardifs, travail sur les sols, ombrage, gestion du feuillage… Les vendanges deviennent aussi un enjeu d’adaptation climatique.
Un moment fort de l’identité viticole
Au-delà de la technique, les vendanges sont aussi un événement culturel et social. C’est un moment où la vigne et le vin retrouvent leur ancrage dans le réel, dans le vivant, dans le geste.
Beaucoup de domaines organisent aujourd’hui :
- Des vendanges participatives
- Des portes ouvertes
- Des expériences oenotouristiques
L’objectif : faire vivre ce moment au grand public, et reconnecter les consommateurs au travail de la terre.
Pourquoi les vendanges sont-elles si cruciales ?
Parce que tout part d’ici. Le profil du vin son équilibre, sa structure, son potentiel de garde, se joue dès la cueillette. Le travail du vigneron est alors à son apogée : il observe, il goûte, il choisit, parfois avec audace.
Les vendanges sont bien plus qu’une simple récolte : elles incarnent le lien entre la terre, le savoir-faire du vigneron et la promesse du vin à venir. Comprendre cette étape, c’est déjà savourer le vin autrement, avec plus de respect, de passion et de conscience.

Obtenez 10% en vous inscrivant à la newsletter


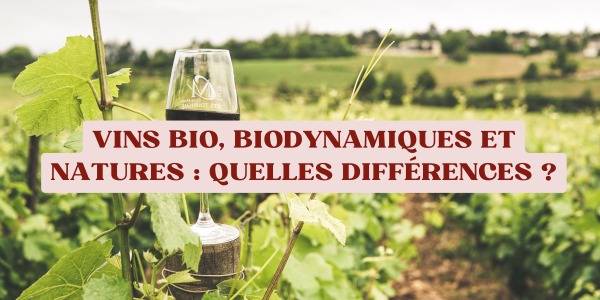





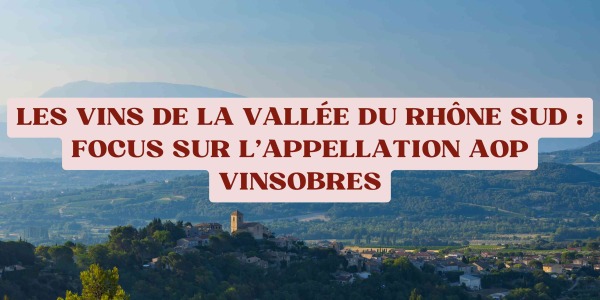





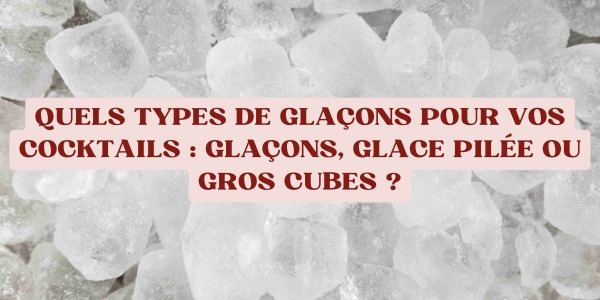
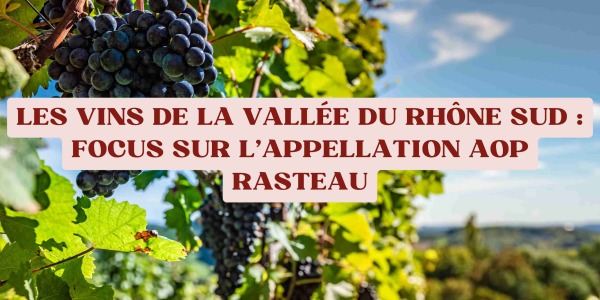

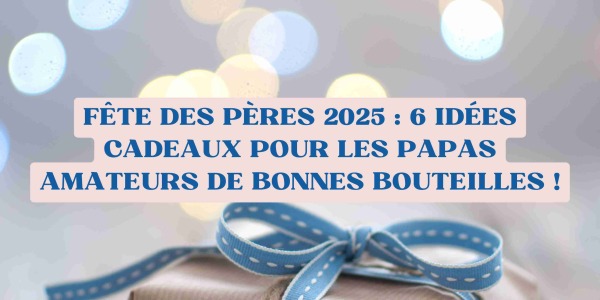
Commentaires (0)